Centre Pompidou du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015
| Marcel
Duchamp, la peinture même Centre Pompidou du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015 |
| De Marcel Duchamp,
j'avais une connaissance plutôt réduite à un urinoir, une
Mariée mise à
nu et à un personnage : Rrose Sélavy. Mais j'ignorais tout de sa
peinture.
Nous
sommes le 24 septembre 2014 et c'est le premièr jour de cette
exposition au Centre Pompidou. Il y a déjà du monde dans les huit
salles qui nous entraînent dans les méandres de la peinture de Marcel
Duchamp jusqu'au Grand Verre. Une exposition propice à questionner notre capacité d'interprétation.
Très tôt,
Duchamp stylise le dessin et ses figures et les insère dans un contexte
abstrait. Il veut créer une peinture “antirétinienne” (ou
“métaréaliste”). Marcel Duchamp explore la littérature et la peinture
symbolistes dans lesquelles l’idée prime sur la vision. En 1911, il
rejoint le groupe des cubistes dont les membres, entre deux parties
d’échecs, débattent des découvertes scientifiques, techniques et
philosophiques de l’époque. Son tableau “Nu descendant un escalier”,
synthèse de cubisme et de futurisme, inspiré des chronophotographies de
Marey et de Muybridge, des théories sur l’optique, ainsi que par la
quatrième dimension qu’on ne peut voir “avec les yeux”, est refusé au
Salon des Indépendants par ses amis cubiste à cause du titre jugé
provocateur. Ce désaveu est, pour Duchamp, l’occasion de
dépasser l’esthétique cubiste.
A
partir de 1911, c’est autour du jeu d’échecs – qu’il considère comme
“une mécanique, puisque cela bouge”, qu’il cristallise une iconographie
toute personnelle, mêlant mouvement, érotisme et mécanique.
“Je
crois que l’art est la seule forme d’activité par laquelle l’homme en
tant que tel se manifeste comme véritable individu. Par elle seule il
peut dépasser le stade animal parce que l’art est un débouché sur des
régions où ne dominent ni le temps, ni l’espace.” Entre
mai 1913 et juin 1915, Marcel Duchamp approfondit ses connaissances en
géométrie, mathématiques, perspective et optique, il accumule des notes
préparatoires au Grand Verre.
|
|
Le Grand verre.
Réalisé à New York entre 1915 et 1923. Se compose de deux panneaux
disposés à la verticale, axe de l’élévation à la fois spirituelle,
érotique, géométrique, physique et physiologique. La Mariée se trouve
dans la partie supérieure, le monde des célibataires dans la partie
inférieure. La frontière entre ces deux mondes, au centre, représente à
la fois “l’horizon et le vêtement défait de la mariée”. Depuis les
tubes capillaires – comme les nomme Duchamp – monte le désir des
célibataires vers la partie supérieure. Ils sont associés à la Broyeuse
de chocolat, située à leur droite, symbole d’un onanisme répétitif.
Dans la partie supérieure, la Mariée, est un “corps écorché”. Elle est
en proie à ses vapeurs et des gaz, qui se concentrent dans le bandeau
situé en haut, de Duchamp intitule la “voie lactée chair” et qu’il dit
animée par trois “pistons de courant d’air”.
L’oeuvre
est un étrange objet qu’il est interdit de photographier, qui serait
très difficile à photographier de par sa transparence. Je glisse
ci-contre la reproduction trouvée dans le dossier pédagogique fort instructif qu'on peut
lire ici.
Agrandir l'ensemble ci-dessous pour voir quelques photos que j'ai ramenées de l'exposition. 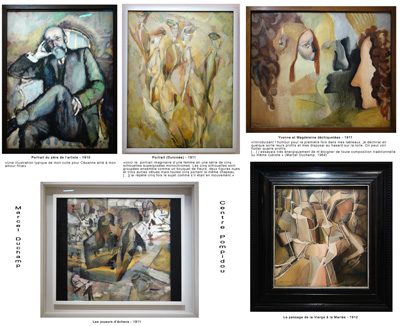 |
 |